Accueil > Avec Flo, çà décoiffe !
Avec Flo, çà décoiffe !
par LE BRIS RENE
Publie le lundi 27 mars 2017 par LE BRIS RENE - Open-Publishing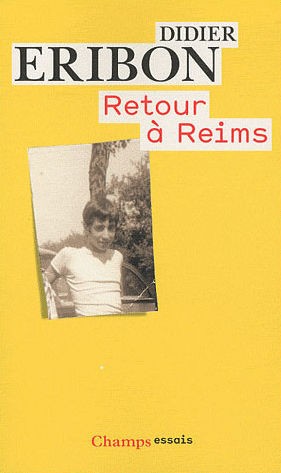
Petits bonheurs sociologiques à relire d’urgence !
FLORINE LE BRIS·DIMANCHE 26 MARS 2017
Didier Eribon, Retour à Reims
Ma manière d’écrire suppose une extériorité socialement située à des milieux et à des gens qui vivent toujours les mêmes types de vie que je m’efforce de décrire et de restituer dans ce livre.... On parle rarement des milieux ouvriers, mais quand on en parle, c’est le plus souvent pour dire qu’on en est sorti et qu’on est heureux d’en être sorti, ce qui réinstalle l’illégitimité sociale de ceux dont on parle au moment où l’on veut parler d’eux, précisément pour dénoncer – mais avec une distance critique nécessaire, et donc un regard évaluant et jugeant – le statut d’illégitimité sociale auquel ils sont inlassablement renvoyés. P98
A propos des mots d’Aron : « Il me semble surtout incontestable que cette absence des sentiments d’appartenir à une classe caractérise les enfances bourgeoises. Les dominants ne perçoivent pas qu’ils sont inscrits dans un monde particulier, situé (de la même manière qu’un Blanc n’a pas conscience d’être blanc, un hétérosexuel d’être hétérosexuel). Dès lors, cette remarque apparaît pour ce qu’elle est : un aveu naïf proféré par un privilégié qui croit qu’il fait de la sociologie alors qu’il ne décrit rien d’autre que son statut social. Je n’ai rencontré ce personnage qu’une seule fois dans ma vie. Il m’aspira une aversion immédiate. J’exécrai son sourire patelin, sa voix doucereuse, cette façon d’afficher son caractère posé et rationnel, tout ce qui au fond n’exprimait rien d’autre que son ethos bourgeois de la bienséance et de la modération idéologique (alors que ces écrits sont empreints d’une violence que ne manqueraient pas de percevoir ceux contre qui elle s’exerce : p101
Wideman [dans son livre Fanon] nous oblige donc à admettre ceci : le fait irréfutable que certains – nombreux, sans doute – s’écartent des voies « statistiques » et déjouent la terrible logique des « chiffres » n’annule en rien, comme voudrait le laisser croire l’idéologie du « mérite personnel », la vérité sociologique révélée par ceux-ci.
Il suffirait de regarder les statistiques de la population carcérale en France et en Europe pour s’en convaincre : les « chiffres » seraient éloquents, qui indiqueraient la « sinistre probabilité » pour les jeunes hommes des banlieues déshérités – et notamment ceux qu’on définit comme « issus de l’immigration » - de se retrouver derrière les barreaux. Et il ne serait pas exagéré de décrire les « cités » autour des villes françaises aujourd’hui comme le théâtre d’une guerre civile larvée : la situation de ces ghettos urbains montre à l’envi comment on traite certaines catégories de la population, comment on les repousse aux marges de la vie sociale et politique, comment on les réduit à la pauvreté, à la précarité, à l’absence d’avenir ; et les grandes révoltes qui embrasent à intervalles réguliers ces « quartiers » ne sont que la condensation soudaine d’une multitude de batailles fragmentaires dont le grondement ne s’arrête jamais. p122
[à propos d’Althusser] « ce fantasme du complot, l’idée qu’une volonté démoniaque est responsable de tout ce qui se passe dans le monde social, hante la pensée critique » (Bourdieu, Réponses. Pour une anthropologie réflexive. p. 78)
Le concept d’Althusser nous renvoie à une vieille logomachie marxiste où des entités à majuscules s’affrontent comme sur la scène d’un théâtre (purement scolastique). [...] certaines des formulations de Bourdieu s’approchent étonnamment de ce qu’il tient tant à récuser, même s’il s’agit moins chez lui de désigner une volonté cachée que des « résultats objectifs ». p123
Quelle responsabilité portent ceux qui, après avoir relégué leur engagement des années 60 et 70 dans le passé révolu des frasques de jeunesse et accédé aux fonctions de pouvoir et aux positions d’importance, s’évertuèrent à imposer les idées de la droite en essayant de renvoyer aux oubliettes de l’histoire tout ce qui avait constitué une des préoccupations essentielles de la gauche, [...] l’attention portée à l’oppression et aux antagonismes sociaux […] p128
Quand on voit ce que sont devenus ceux qui se grisaient de la mythologie de l’insurrection prolétarienne ! Ils sont toujours aussi sûrs d’eux-mêmes, et aussi véhéments, mais, à quelques rares exceptions près, c’est aujourd’hui pour dénoncer la moindre velléité de protestation venue des quartiers populaires. Ils ont rejoint ce à quoi ils étaient socialement promis, ils sont devenus ce qu’ils devaient devenir et ils se sont transformés par là-même en ennemis de ceux dont ils prétendaient hier incarner l’avant-garde et qu’ils jugeaient trop timorés et trop « embourgeoisés ». On raconte que Marcel Jouhandeau, voyant passer un cortège d’étudiants en Mai 68, leur lança : « Rentrez chez vous ! Dans 20 ans, vous serez tous notaires. » […] Notaires, peut-être pas, mais notables, à n’en pas douter, installés politiquement, intellectuellement, personnellement, au terme de trajectoires souvent stupéfiantes, dans le confort de l’ordre social et la défense du monde tel qu’il est, c’est-à-dire tel qu’il convient parfaitement à ce qu’ils sont désormais.p129
[1981] La gauche socialiste […] commençait de se placer avec un enthousiasme suspect sous l’emprise d’intellectuels néo conservateurs qui, sous couvert de renouveler la pensée de gauche, travaillaient à effacer tout ce qui faisait que la gauche était la gauche. […] On ne parla plus d’exploitation et de résistance, mais de « modernisation nécessaire » et de « refondation sociale » ; plus de rapports de classe, mais de « vivre-ensemble » ; plus de destins sociaux mais de « responsabilité individuelle ». La notion de domination et l’idée d’une polarité structurante entre les dominants et les dominés disparurent du paysage politique de la gauche officielle, au profit de l’idée neutralisante de « contrat social », de « pacte social », dans le cadre desquels des individus définis comme « égaux en droits » (« égaux » ? Quelle obscène plaisanterie !) étaient appelés à oublier leurs « intérêts particuliers » (càd à se taire et à laisser les gouvernants gouverner comme ils l’entendaient). Quels furent les objectifs idéologiques de cette « philosophie politique », diffusée et célébrée […] de la droite à la gauche (ses prometteurs s’évertuant d’ailleurs à effacer la frontière entre la gauche et la droite, en attirant, avec le consentement de celle-ci, la gauche vers la droite) ? L’enjeu était à peine dissimulé : l’exaltation du « sujet autonome » et la volonté concomitante d’en finir avec les pensées qui s’attachaient à prendre en considération les déterminismes historiques et sociaux eurent pour principale fonction de défaire l’idée qu’il existait des groupes sociaux – des « classes » - et de justifier ainsi le démantèlement du welfare state et de la protection sociale, au nom d’une nécessaire individualisation (ou décollectivisation, désocialisation) du droit du travail et des systèmes de solidarité et de distribution. Ces vieux discours […] de la droite […] devinrent aussi ceux d’une bonne partie de la gauche. P130-1
Tout au plus daigna-t-on, dans les versions chrétiennes ou philanthropiques de ces discours néoconservateurs, remplacer les opprimés et les dominés d’hier – et leurs combats – par les « exclus » d’aujourd’hui – et leur passivité présomptive – et se pencher sur eux comme les destinataires potentiels, mais silencieux, de mesures technocratiques destinées à aider les « pauvres » […] p132
Le fait qu’ait pu prospérer le concept aussi inepte que réactionnaire d’« individualisme de masse » pour analyser la « précarisation » du monde du travail nous renseigne beaucoup plus sur la triste trajectoire, les menant de la gauche critique vers les cénacles technocratiques et la pensée néoconservatrice, des sociologues qui l’utilisent que sur la réalité des « métamorphoses de la question sociale ».
Sur la transformation des discours et des politiques économiques, voir Frédéric Lebaron, Le savant, la politique et la mondialisation.
Cette mutation des discours politiques transforma la perception du monde social et donc, de façon performative, le monde social lui-même, puisqu’il est, dans une large mesure, produit par les catégories de pensée à travers lesquelles on le regarde. Mais faire disparaître des discours politiques les « classes » et les rapports de classe, les effacer des catégories théoriques et cognitives n’empêche nullement ceux qui vivent la condition objective que le mot « classe » servait à désigner de se sentir collectivement délaissés par ceux qui leur prêchent les bienfaits du « lien social » […] Des pans entiers des couches les plus défavorisées allaient donc, comme par un effet quasi automatique de redistribution des cartes politiques, se tourner vers le parti qui semblait être le seul à se préoccuper d’elles et, en tout cas, offrait un discours s’efforçant de redonner un sens à leur expérience vécue. Et cela bien que les instances dirigeantes de ce parti n’aient pas été composées, loin s’en faut, de membres issus des classes populaires, contrairement à ce qui avait été le cas au Parti Communiste, où l’on veillait à sélectionner des militants venant du monde ouvrier, en lesquels les électeurs pouvaient se reconnaître. p132-3
on défendait en silence ce qu’il restait de cette identité désormais ignorée, quand elle n’était pas méprisée par les hiérarques de la gauche institutionnelle, tous issus de l’ENA et autres écoles bourgeoises du pouvoir technocratique, c’est-à-dire de ces lieux où se produit et s’enseigne une « idéologie dominante », devenue largement transpolitique (on n’insistera jamais assez sur le degré de participation des cénacles de la gauche « moderniste » - et souvent chrétienne – à l’élaboration de cette idéologie dominante de droite. P134
la signification d’un « nous » ainsi maintenu ou reconstitué se transforma au point de désigner « les Français » opposés aux « étrangers », plutôt que les « ouvriers » opposés aux « bourgeois », ou, plus exactement, si l’opposition entre « ouvriers » et « bourgeois », perdurant sous la forme d’une opposition entre « gens d’en bas » et « gens d’en haut » (mais cela n’est pas la même chose et n’emporte pas les mêmes conséquences politiques), intégra une dimension nationale et raciale, les gens d’en haut étant perçus comme favorisant l’immigration et ceux d’en bas comme souffrant dans leur vie quotidienne et celle-ci, accusée d’être responsable de tous leurs maux.
On pourrait avancer que le vote communiste représentait une affirmation positive de soi et le vote pour le Front national une affirmation négative de soi (le rapport aux structures partisanes, aux porte-parole, à la cohérence du discours politique et à sa coïncidence avec l’identité de classe, etc., étant très fort et même décisif dans le premier cas, quasi inexistant ou très secondaire dans le second). P135
La belle analyse proposée par Sartre du vote et des périodes électorales comme processus d’individualisation et, donc, de dépolitisation de l’opinion – la situation de « sérialité » -, par opposition à la formation collective et politisante de la pensée au cours d’un mouvement ou d’une mobilisation – le « groupe » -, trouve ici ses limites. p137
On pourrait être tenté de dire qu’il s’agit d’un collectif sériel, puisque ce sont les pulsions immédiates, les opinions partagées mais reçues plutôt que les intérêts réfléchis en commun et les opinions élaborées dans l’action pratique qui y prédominent, la vision aliénée (dénoncer les étrangers) plutôt que la conception politisée (combattre la domination). P140
Cela ne signifie évidemment pas que l’extrême gauche serait à placer sur le même plan que l’extrême droite, comme sont prompts à le proclamer ceux qui entendent protéger leur monopole sur la définition de la politique légitime en taxant systématiquement de « populisme » tout point de vue et toute affirmation de soi échappant à cette définition, quand une telle accusation ne renvoie à rien d’autre qu’à leur incompréhension – de classe – devant ce qu’ils considèrent comme l’« irrationalité » du peuple lorsqu’il ne consent pas à se soumettre à leur « raison » et à leur « sagesse ». p142
En fait, quand on votait à gauche, on votait d’une certaine manière contre ce type de pulsions immédiates, et donc contre une partie de soi-même. Ces sentiments racistes étaient certes puissants et, d’ailleurs, le Parti communiste ne se priva pas de les flatter, de manière odieuse, en de nombreuses occasions. Mais ils ne se sédimentaient pas comme le foyer central de la préoccupation politique. Et même, on se sentait parfois obligé de s’en excuser lorsqu’on se trouvait dans un cercle plus large que celui de la famille restreinte. […] Il fallut du temps pour que les expressions quotidiennes du racisme ordinaire en viennent à s’agréger à des éléments plus directement idéologiques et à se transformer en mode hégémonique de perception du monde social, sous l’effet d’un discours organisé qui s’attachait à les encourager et à leur donner un sens sur la scène publique. P147-8
j’en arrive à me demander si le racisme de ma mère, et le mépris virulent qu’elle (fille d’un immigré !) afficha toujours à l’égard des travailleurs immigrés en général, et des « Arabes » en particulier, ne fut pas un moyen pour elle, qui avait appartenu à une catégorie sociale constamment rappelée à son infériorité, de se sentir supérieure à des gens plus démunis encore. Une manière de se construire une image valorisante d’elle-même, par le biais de la dévalorisation des autres, c’est-à-dire une manière d’exister à ses propres yeux. P151-2
Pendant les années 1960 et 1970, le discours de mes parents mêlait déjà deux formes de partage entre « eux » et « nous » : le partage de classe (les riches et les pauvres) et le partage ethnique ( les « Français » et les « étrangers »). Pourtant, certaines circonstances politiques et sociales pouvaient déplacer l’accent sur l’un ou sur l’autre. En Mai 68, les grandes grèves unissaient les « travailleurs », quelle que soit leur origine, contre les « patrons ». […] Sartre a raison d’insister sur ce point : avant la grève, l’ouvrier français est spontanément raciste, se méfie des immigrés, mais une fois l’action déclenchée, ces mauvais sentiments s’effacent et c’est la solidarité qui prédomine (fût-ce partiellement et temporairement). C’est donc très largement l’absence de mobilisation ou de perception de soi comme appartenant à un groupe social mobilisé […] qui permet à la division raciste de supplanter la division en classes. Dès lors, le groupe, dont la mobilisation comme perception de soi a été dissoute par la gauche, se reconstitue autour de ce principe, national cette fois : l’affirmation de soi comme occupant « légitime » d’un territoire dont on se sent dépossédé et chassé – le quartier où l’on habite et qui remplace le lieu de travail et la condition sociale dans la définition de soi-même et de son rapport aux autres. Et, plus généralement, l’affirmation de soi comme maître et possesseur naturel d’un pays dont on revendique le bénéfice exclusif des droits qu’il accorde à ses citoyens. L’idée que d’« autres » puissent profiter de ces droits – le peu que l’on a – devient insupportable, dans la mesure où il apparaît qu’il faut les partager et donc voir diminuer la part qui revient à chacun.
Il conviendrait néanmoins de pousser l’analyse jusqu’au point de se demander si, lorsqu’on essaie d’expliquer pourquoi à tel ou tel moment les classes populaires votent à droite, on ne présuppose pas qu’il serait naturel qu’elles votent à gauche, en dépit du fait que ce n’est pas toujours le cas, et jamais complètement. Même quand le PC prospérait électoralement comme « parti de la classe ouvrière », seuls 30% des ouvriers lui apportaient leurs suffrages, et ils étaient au moins aussi nombreux, si ce n’est plus, à voter pour les candidats de la droite que pour ceux de la gauche dans son ensemble. Et cela ne concerne pas seulement le vote. Même les mobilisations ouvrières ou populaires, les actions menées en commun purent, au cours de l’histoire, être ancrées à droite ou, en tout cas, tourner le dos aux valeurs de la gauche : le mouvement des « Jaunes », par exemple, au début du XXème siècle, ou les émeutes racistes dans le sud de la France à la même époque ; ou encore les grèves contre l’embauche d’ouvriers étrangers (cf. La Droite révolutionnaire, 1885-1914, Paris, Fayard, 2000)... Nombreux furent les théoriciens de gauche qui cherchèrent à décrypter ces phénomènes : qu’on songe à Gramsci qui se demande, dans ses Cahiers de prison, pourquoi, alors que les conditions semblaient réunies en Italie, au sortir de la 1ère Guerre mondiale, pour que se déclenche une révolution socialiste et prolétarienne, celle-ci avorta ou, plus exactement, se produisit mais sous la forme d’une révolution fasciste ; ou encore Wilheim Reich qui cherche à analyser, dans La psychologie de masse du fascisme, en 1933, les processus psychiques qui amenèrent les classes populaires à désirer le fascisme. Par conséquent, le lien qui paraît évident entre la « classe ouvrière » et la gauche pourrait bien relever d’une représentation construite historiquement par des théories (le marxisme, par exemple) qui ont façonné et notre perception du monde social, et nos catégories politiques. P152-155
Et je crains fort que les intellectuels qui, manifestant ainsi leur ethnocentrisme de classe et projetant leurs propres modes de pensée dans la tête de ceux à la place desquels ils parlent en prétendant être attentifs à leurs paroles, se gargarisent des « savoirs spontanés » des classes populaires – et ce avec d’autant plus d’enthousiasme qu’ils n’ont jamais rencontré dans leur vie quelqu’un qui y appartienne, si ce n’est en lisant des textes du XIXème siècle – ne courent le risque de se heurter à de cinglants démentis et à de cruelles déconvenues. C’est précisément de ces mythologies et de ces mystifications, que certains s’acharnent à perpétuer (pour se faire applaudir comme les tenants d’une nouvelle radicalité), autant que des dérives néoconservatrices évoquées antérieurement, que la gauche doit se défaire si elle veut comprendre les phénomènes qui la conduisent à sa ruine et espérer un jour les contrecarrer. Il n’y a pas de « savoir spontané » des dominés, ou, plus exactement, le « savoir spontané » n’a pas de signification fixe et liée à telle ou telle forme de politique : la position des individus dans le monde social et dans l’organisation du travail ne suffit pas à déterminer l’« intérêt de classe » ou la perception de cet intérêt sans la médiation des théories à travers lesquelles des mouvements et des partis proposent de voir le monde. Ce sont ces théories qui donnent forme et sens aux expériences vécues à un moment ou à un autre, et les mêmes expériences peuvent revêtir des significations opposées selon les théories ou les discours vers lesquels elles vont se tourner et auxquelles elles vont s’adosser (cf. Joan W. Scott, « L’évidence de l’expérience », in Théorie critique de l’histoire. Identités, expériences, politiques, Paris, Fayard, 2009, p.65-126).
C’est pourquoi une philosophie de la « démocratie » qui se contente (même si ses auteurs s’émerveillent eux-mêmes d’avancer une pensée aussi « scandaleuse ») de célébrer l’« égalité » première de tous avec tous et de ressasser que chaque individu serait doté de la même « compétence » que tous les autres n’est en rien une pensée de l’émancipation, dans la mesure où elle ne s’interroge jamais sur les modalités de la formation des opinions ni sur la manière dont ce qui résulte de cette « compétence » peut s’inverser de tout au tout – pour le meilleur ou pour le pire – chez une même personne ou dans un même groupe social, selon les lieux et les conjonctures, et selon les configurations discursives à l’intérieur desquelles, par exemple, les mêmes préjugés peuvent soit devenir la priorité absolue, soit être tenus à l’écart du registre politique (cf. Stuart Hall dans The Hard Road to Renewal). Je n’aimerais pas que ma mère ou mes frères – qui n’en demandent d’ailleurs pas tant – soient « tirés au sort » pour gouverner la Cité au nom de leur « compétence » égale à celle de tous les autres : leurs choix n’y seraient pas différents de ceux qu’ils expriment quand ils votent, à ceci près qu’ils pourraient bien être majoritaires. Et tant pis si mes réticences doivent froisser les adeptes d’un retour aux sources athéniennes de la démocratie. Car si le geste de ces derniers peut sembler sympathique, ce qui risquerait d’en découler m’inquiète au plus haut point (Rancière semble avoir lui-même vaguement conscience du problème sans jamais le formuler, puisque tous les exemples d’expressions démocratiques qu’il mentionne nous renvoient à ce qu’il désigne du mot « luttes », ou « mouvements », c’est-à-dire à des manifestations collectives et organisées de l’opinion dissidente. Cela indique que le « pouvoir du peuple » comme fondement de la démocratie n’est jamais celui des individus indifférenciés et interchangeables : il est toujours déjà inscrit dans des cadres sociaux et politiques hétérogènes et conflictuels entre eux. Ce sont ces cadres qu’une réflexion sur la démocratie doit placer au cœur de ses interrogations et de ses préoccupations).
Et comment, d’autre part, prendre en considération l’existence pratique des « classes sociales » et de la conflictualité sociale, et même de la « guerre » objective dont j’ai parlé dans un chapitre précédent, sans verser dans l’invocation magico-mythique de la « Lutte des classes » qu’exaltent aujourd’hui ceux qui prônent un « retour au marxisme », comme si les positions politiques découlaient de manière univoque et nécessaire des positions sociales et conduisaient inéluctablement à un affrontement conscient et organisé d’une « classe ouvrière », sortie de son « aliénation » et animée par un désir de socialisme, et de la « classe bourgeoise », avec tous les aveuglements que de telles notions réifiées et de telles représentations fantasmatiques impliquent – et donc des dangers qu’elles représentent ?
Il nous faut au contraire essayer de comprendre pourquoi et comment les classes populaires peuvent penser leurs conditions de vie tantôt comme les ancrant nécessairement à gauche, tantôt comme les inscrivant évidemment à droite. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte : la situation économique, globale ou locale, bien sûr, les transformations du travail et des types de liens entre les individus que de telles transformations font et défont, mais aussi, et je serai tenté de dire surtout, la manière dont les discours politiques, les catégories discursives, viennent façonner la subjectivation politique. Les partis jouent ici un rôle important, si ce n’est fondamental, puisque, on l’a vu, c’est par leur intermédiaire que peuvent parler ceux qui ne parleraient pas si des porte-parole ne parlaient pas pour eux, c’est-à-dire en leur faveur mais aussi à leur place (cet élément crucial qu’est la médiation des partis est absent dans le modèle de Sartre (qui était sous l’emprise, à l’époque de son texte sur le vote, du spontanéisme gauchiste). Il est au contraire souligné par Bourdieu dans son article « Le mystère du ministère. Des volontés particulières à la ’’volonté générale’’ », Actes de la recherche en sciences sociales, n°140, 2001, p.7-13). Un rôle fondamental aussi parce que ce sont les discours organisés qui produisent les catégories de perception, les manières de se penser comme sujet politique et qui définissent la conception que l’on se fait de ses propres « intérêts » et des choix électoraux qui en découlent. Il convient donc de réfléchir en permanence sur cette antinomie entre le caractère inéluctable, pour les classes populaires, de la délégation de soi – en dehors de rares moments de lutte – et le refus de se laisser déposséder par des porte-parole dans lesquels on finit par ne plus se reconnaître, au point de s’en chercher et de s’en donner d’autres. C’est pourquoi, d’ailleurs, il est d’une importance capitale de se défier toujours des partis et de leur tendance naturelle à vouloir assurer leur hégémonie sur la vie politique, et de la tendance naturelle de leurs dirigeants à vouloir assurer leur hégémonie sur ce qui délimite le champ de la politique légitime (avec le soutien, bien sûr, d’intellectuels de parti et de gouvernement qui entendent délimiter ce qui est politique et ce qui ne l’est pas, ce qui est ’’démocratique’’ et ce qui est ’’contre-démocratique’’, etc., autant de tentatives qui représentent le contraire de ce que devraient être et le travail intellectuel – penser le monde social dans sa mobilité au lieu de chercher à le prescrire -, et l’activité démocratique, qui ne se laisse pas enfermer dans les diktats de ces idéologues autoritaires liés à toutes les technocraties et à toutes les bureaucraties, c’est-à-dire à toutes les institutions et à tous les pouvoirs. A titre d’antidote salvateur à ces pulsions antidémocratiques, on lira le livre de Sandra Laugier, Une autre pensée politique américaine. La démocratie radicale d’Emerson à Stanley Cavell, Paris, Michel Houdiard, 2004).
Nous voici ramenés à la question de savoir qui a droit à la parole, qui prend part, et de quelle manière, aux processus de décision, c’est-à-dire non seulement à l’élaboration des solutions, mais aussi à la définition collective des questions qu’il est légitime et important d’aborder. Quand la gauche se révèle incapable de s’organiser comme l’espace et le creuset où se forment les questionnements mais aussi où s’investissent les désirs et les énergies, c’est la droite ou l’extrême droite qui réussissent à les accueillir et à les attirer.
C’est donc la tâche qui incombe aux mouvements sociaux et aux intellectuels critiques : construire des cadres théoriques et des modes de perception politiques de la réalité qui permettent non pas d’effacer – tâche impossible – mais de neutraliser au maximum les passions négatives à l’œuvre dans le corps social et notamment dans les classes populaires ; d’offrir d’autres perspectives et d’esquisser ainsi un avenir pour ce qui pourrait s’appeler, à nouveau, la gauche. P.155-160
[Dans Esquisse pour une auto-analyse,] Bourdieu n’explique pas […] comment il surmonta ces difficultés et parvint à se maintenir dans un univers que tout en lui rejetait en même temps qu’il aspirait à n’en surtout pas sortir. C’est cette ambivalence qui lui permit de devenir ce qu’il devint et qui anima tout son projet intellectuel et toute sa démarche ultérieure : la révolte – la « fureur butée » - continuée dans et par le moyen du savoir. Ce que Foucault appellera, de son côté, l’« indocilité réfléchie ».
Il ne mentionne aucun des livres qu’il lisait, ne donne aucun renseignement sur ceux qui comptèrent pour lui ou lui donnèrent le goût de la culture, de la pensée, quand il aurait pu sombrer dans un rejet complet de celles-ci, comme semblaient l’y destiner les valeurs populaires sportives et masculinistes auxquelles il ne se cache pas qu’il adhérait pleinement, bien qu’il ait refusé l’anti-intellectualisme de ceux avec qui il les partageait. Il souligne d’ailleurs qu’il voyait disparaître du paysage scolaire, les uns après les autres, année après année, ceux qui venaient du même milieu social que lui et qui adhéraient à ces mêmes valeurs. p.165-6
Quid de la sexualité ? L’hétérosexualité va-t-elle de soi au point qu’il serait inutile de la nommer, de la montrer, si ce n’est, en contrepoint, dans l’évocation fugace d’un élève de sa classe qui jouait du violon et qui, « reconnu comme homosexuel », devait subir une véritable persécution de la part des autres, qui manifestaient ainsi qu’ils ne l’étaient pas, selon une très classique opposition entre les esthètes et les athlètes (ces derniers se trouvant être les mêmes, dans le récit de Bourdieu, que ceux avec qui il jouait au rugby et qu’il voyait peu à peu éliminés du cursus scolaire (sur le lien entre les valeurs masculinistes des garçons appartenant aux milieux ouvriers ou populaires – notamment le rejet de l’autorité et l’hostilité à l’encontre de bons élèves jugés « conformistes » - et l’élimination scolaire, et donc l’assignation à des métiers ouvriers, voir Paul Willis, Learning to Labour. How Working Class Kids Get Working Class Jobs, Westmead (G.-B.), Saxon House, 1977)) ? p.167
[par rapport à Foucault,] il avait « en commun avec lui presque toutes les propriétés pertinentes » en précisant néanmoins : « Presque toutes sauf deux, mais qui ont eu selon moi un poids très important dans la constitution de son projet intellectuel : il était issu d’une famille de bonne bourgeoisie provinciale et homosexuel. » Et il en ajoute une troisième, à savoir « le fait qu’il était et se disait philosophe », mais celle-ci, précise-t-il, n’est peut-être qu’un « effet des précédentes ». Ces remarques me paraissent très justes, et même incontestables. Mais l’inverse doit être vrai également : le choix de la sociologie par Bourdieu, et la physionomie même de son œuvre, pourraient bien être liés à son origine sociale et à sa sexualité. Comme on le voit notamment dans le jugement qu’il porte, de manière plus générale, sur la philosophie, contre laquelle il mobilise, au nom de la sociologie et de la « science », tout un vocabulaire structuré par une opposition du masculin au féminin, ce dont il aurait dû être conscient, lui qui avait si magistralement étudié ces polarités binaires aussi bien dans ses études sur la Kabylie que dans son analyse du champ universitaire et de sa division en disciplines (sur les catégories masculinistes – et de classe – à l’œuvre dans le discours par lequel la sociologie se constitue comme « science » en s’opposant à la philosophie, voir Geoffroy de Lagasnerie, « L’inconscient sociologique. Émile Durkheim, Claude Lévi-Strauss et Pierre Bourdieu au miroir de la philosophie », Les Temps modernes, n°654, 2009, p.99-108). p.168-9
Parce qu’elle est un vecteur de « distinction », c’est-à-dire de différenciation de soi d’avec les autres, de mise à distance des autres, d’écart institué avec eux, l’adhésion à la culture constitue souvent pour un jeune gay, notamment issu des classes populaires, le mode de subjectivation qui lui permettra de donner un appui et un sens à sa « différence » et, par conséquent, de se bâtir un monde, de se forger un ethos autre que celui qui lui vient de son milieu social. p.170
le type de rapport à soi qu’impose la culture scolaire se révélait incompatible avec ce qu’on était chez moi, et la scolarisation réussie installait en moi, comme une de ses conditions de possibilité, une coupure, un exil même, de plus en plus marqués, me séparant peu à peu du monde d’où je venais et où je vivais encore. Et comme tout exil, celui-ci contenait une forme de violence. Je ne la percevais pas, puisque c’est avec mon consentement qu’elle s’exerçait sur moi. […] Pendant plusieurs années, il me fallut passer d’un registre à l’autre, d’un univers à l’autre, mais cet écartèlement entre les deux personnes que j’étais, entre les deux rôles que je devais jouer, entre mes deux identités sociales, de moins en moins liées l’une à l’autre, de moins en moins compatibles entre elles, produisait en moi une tension bien difficile à supporter et, en tout cas, fort déstabilisante. p.171
Je ne pouvais rivaliser. J’étais sans cesse renvoyé à mon infériorité. Il était cruel et blessant sans le vouloir, sans le savoir. J’ai souvent rencontré par la suite des situations analogues : où les ethos de classe sont au principe de comportements et de réactions qui ne sont que l’actualisation des structures et des hiérarchies sociales dans le moment d’une interaction. L’amitié n’échappe pas aux lois de la pesanteur historique : deux amis, ce sont deux histoires sociales incorporées qui tentent de coexister, et parfois, dans le cours d’une relation, si étroite soit-elle, ce sont deux classes qui, par un effet d’inertie des habitus, se heurtent l’une à l’autre. Les attitudes, les propos n’ont pas besoin d’être agressifs au sens fort du terme, ni intentionnellement blessants, pour l’être malgré tout. p.176
Toujours est-il que ce garçon brièvement fréquenté au lycée me donna le goût des livres, un rapport différent à la chose écrite, une adhésion à la croyance littéraire ou artistique, qui ne furent au début que joués, et qui devinrent chaque jour un peu plus réelles. Au fond, c’est l’enthousiasme qui comptait, et le désir de tout découvrir. Le contenu vint après. Grâce à cette amitié, mon rejet spontané – c’est-à-dire fruit de mon origine sociale – de la culture scolaire ne déboucha pas sur un refus de la culture tout court, mais se transmua en une passion pour tout ce qui touchait à l’avant-garde, à la radicalité, à l’intellectualité (Duras et Beckett me séduisaient, mais Sartre et Beauvoir leur disputèrent bientôt la suprématie dans mon coeur […]). p.178
Je déguisais mon inculture, mon ignorance des classiques, le fait que je n’avais quasiment rien lu de tout ce que les autres avaient lu à mon âge, en attitude hautaine et méprisante à leur égard, me moquant de leur conformisme : ils me traitaient de « snob », ce qui, évidemment, me ravissait. Je m’inventai une culture, en même temps qu’une personnalité et un personnage. p.179
Là encore, l’ignorance des hiérarchies scolaires et l’absence de maîtrise des mécanismes de sélection conduisent à opérer les choix les plus contre-productifs, à élire les parcours condamnés, en s’émerveillant d’avoir accès à ce qu’évitent soigneusement ceux qui savent. En fait, les classes défavorisées croient accéder à ce dont elles étaient auparavant exclues, alors que, quand elles y accèdent, ces positions ont perdu la place et la valeur qu’elles avaient dans un état antérieur du système. La relégation s’opère plus lentement, l’exclusion se produit plus tardivement, mais l’écart entre les dominants et les dominés reste intact : il se reproduit en se déplaçant. C’est ce que Bourdieu appelle la « translation de la structure » (Pierre Bourdieu, La Distinction, Paris, Minuit, 1979, p. 145 sv.). p.183-4
Je me passionnais pour les marxistes humanistes des pays de l’Est, et notamment Karel Kosik, dont La Dialectique du concret exerçait sur moi une étrange séduction : je n’ai gardé aucun souvenir de ce livre, si ce n’est qu’il me plaisait tellement que je le lus et relus plusieurs fois d’un bout à l’autre en deux ou trois ans. J’admirais aussi Histoire et conscience de classe du premier Lukàcs (je vomissais le second, celui des années 1950, à cause de ses attaques staliniennes contre Sartre et l’existentialisme dans La Destruction de la raison), Karl Korsch et quelques autres auteurs qui défendaient un marxisme ouvert, non dogmatique, tel Lucien Goldmann, sociologue aujourd’hui bien oublié, peut-être injustement d’ailleurs, mais à l’époque très important, dont Le Dieu caché et Sciences humaines et philosophie m’apparaissaient comme des sommets de la sociologie des œuvres... p.186
Nous avions droit à des cours sur Plotin et Maine de Biran, mais jamais sur Spinoza, Hegel ou Husserl, qui semblaient n’avoir pas existé. Quant à la « philosophie contemporaine », elle n’allait pas plus loin que l’existentialisme. Durant les quatre années que je passai dans ce département, je n’entendis jamais parler de Lévi-Strauss, Dumézil, Braudel, Benveniste, Lacan... dont l’importance était depuis fort longtemps reconnue. Ni, cela va sans dire, d’auteurs tels que Althusser, Foucault, Derrida, Deleuze, Barthes... p.189
Même s’il ne versait pas dans l’homophobie qui régnait au Parti communiste ou dans les mouvements maoïstes, le militantisme trotskiste était foncièrement hétérosexiste ou en tout cas peu accueillant à l’homosexualité. L’on y récitait alors un catéchisme reichien sur la « révolution sexuelle », un freudo-marxisme dans lequel la condamnation de l’homosexualité par le marxisme traditionnel se mêlait à celle portée par la psychanalyse : l’idée selon laquelle la société bourgeoise reposerait sur la répression de la libido et sur le détournement de l’énergie libidinale vers la force de travail, et que, par conséquent, la libération sexuelle contribuerait à l’avènement d’un autre système social et politique, contenait un jugement dépréciatif sur l’homosexualité, considérée comme un simple effet des tabous sexuels, destiné à disparaître avec ceux-ci. En réalité, j’éprouvais tous les jours qu’il n’y avait pas de place pour moi dans le marxisme et, à l’intérieur de ce cadre comme partout, je devais vivre une vie divisée. p.205
L’injure réelle ou potentielle – c’est-à-dire celle que l’on reçoit effectivement ou celle que l’on redoute de recevoir, en tâchant d’en déjouer l’irruption, ou celle encore, obsédante et violente, par laquelle on se sent assailli partout et toujours – constitue dès lors l’horizon du rapport au monde et aux autres. L’être-au-monde s’actualise dans un être-insulté, c’est-à-dire infériorisé par le regard social et la parole sociale. p.208
De toute façon, par un mélange de puritanisme gauchiste et d’élitisme intellectuel ou qui se croyait tel, je considérais alors les bars et les boîtes de nuit comme des divertissements condamnables ou en tout cas méprisables. p.213
Pourquoi certaines catégories de la population – gays, lesbiennes, transsexuels, ou Juifs, Noirs, etc. - doivent-elles porter le fardeau de ces malédictions sociales et culturelles dont on a bien du mal à concevoir ce qui les motive et les réactive inlassablement ? Je me suis longtemps posé cette question : « Pourquoi ? » Et aussi celle-ci : « Mais qu’avons-nous fait ? » Il n’est pas d’autre réponse à ces interrogations que l’arbitraire des verdicts sociaux, leur absurdité. Et comme dans Le Procès de Kafka, il est inutile de chercher le tribunal qui prononce ces jugements. Il ne siège pas, il n’existe pas. Nous arrivons dans un monde où la sentence a déjà été rendue, et nous venons, à un moment ou à un autre de notre vie, occuper la place de ceux qui ont été condamnés à la vindicte publique, à vivre avec un doigt accusateur pointé sur eux, et à qui il ne reste qu’à tâcher tant bien que mal de se protéger d’elle et de réussir à gérer cette « identité pourrie », comme le dit le sous-titre anglais du livre d’Erving Goffman, Stigmate. Cette malédiction, cette condamnation avec lesquelles il faut vivre installent un sentiment d’insécurité et de vulnérabilité au plus profond de soi-même, et une sorte d’angoisse diffuse qui marque la subjectivité gay. p.223
On comprend pourquoi le climat qui règne dans les premiers textes de Foucault, tout au long des années 1950, de sa préface au livre de Ludwig Binswanger Le Rêve et l’existence en 1954 (où il est si proche, dans son intérêt pour la psychiatrie existentielle, du Fanon sartrien de Peaux noires, masques blancs, paru deux ans plus tôt) jusqu’à l’Histoire de la folie terminée en 1960, est précisément celui de l’angoisse, qu’exprime tout le vocabulaire, qu’il mobilise avec une troublante intensité, de l’exclusion, de l’extranéité, de la négativité, du silence contraint, et même de la chute et du tragique. A l’instar de Georges Dumézil, qui aimait à placer sa recherche sous l’égide du dieu Loki, en décrivant ce personnage du panthéon scandinave, avec ses transgressions sexuelles et son refus de l’ordre établi, comme le client idéal aujourd’hui pour une fiche psychiatrique bien remplie, ce qui à ses yeux était un compliment, c’est pour le promouvoir au grand jour, en faire accéder les balbutiements à la parole rendue à son plein droit que Foucault entreprit d’étudier cet « Enfer » de la « négativité » humaine et de l’« angoisse » que le regard médical cherchait à arraisonner et à réduire au silence.
Quand je relis ces textes incandescents et douloureux de Foucault, qui inaugurèrent son œuvre, j’y reconnais quelque chose de moi : j’ai vécu ce qu’il écrit, et qu’il avait vécu avant moi, cherchant un moyen de l’écrire. Je sais à quel point il lui fut difficile de surmonter ces difficultés. Il tenta à plusieurs reprises de se suicider. Et il chemina longtemps en équilibre incertain sur la ligne qui sépare la raison de la folie (Althusser le dit superbement dans son autobiographie à propos de celui en qui il savait avoir un frère en « malheur »). Il s’en sortit par le moyen de l’exil (en Suède d’abord), puis par le patient labeur d’une mise en question radicale du discours pseudo-scientifique de la pathologisation médicale. Il opposa alors le cri de la Déraison, catégorie qui englobe notamment la folie et l’homosexualité, au milieu d’autres « déviances », au monologue que la psychiatrie, ce par quoi il désigne le discours des normaux et de la normalité, tient sur ceux qu’elle considère comme ses « objets » et qu’elle tente de maintenir dans la subordination. p.225
Dans la suite de son œuvre, au fil de ses remaniements successifs, Foucault ne cessera de poursuivre le même but : penser l’affrontement du sujet au pouvoir de la norme, réfléchir aux façons dont on peut réinventer son existence. Il n’est donc pas surprenant que ses textes touchent à ce point leurs lecteurs (certains d’entre eux en tout cas, puisque tant d’autres n’y voient que matière à glose académique) : c’est parce qu’ils parlent d’eux et s’adressent en eux aux failles et aux fêlures, c’est-à-dire à la fragilité, mais aussi à la rétivité et au goût du refus qui peuvent naître de celle-ci.
A n’en pas douter, nous pouvons ranger Histoire de la folie sur les rayons de nos bibliothèques, ou plutôt de nos « sentimenthèques », selon le mot forgé par Patrick Chamoiseau pour désigner les livres qui nous « font des signes » et nous aident à combattre en nous-mêmes les effets de la domination, à côté d’un autre grand livre dont l’intention fut de contester le regard social et médical sur les déviants, et de rendre, ou de donner, à ceux-ci un statut de sujet du discours et non plus d’objet, de faire entendre leurs paroles qui contestent et récusent la parole que les autres tiennent sur eux : il s’agit, bien sûr, du Saint Genet de Sartre. p.226
il arrive un moment où l’on transmue les crachats en roses, les attaques verbales en une guirlande de fleurs, en rayons de lumière. Bref, un moment où la honte se transforme en orgueil... Et cet orgueil est politique de part en part, puisqu’il défie les mécanismes les plus profonds de la normalité et de la normativité. On ne reformule donc pas ce qu’on est à partir de rien : on accomplit un travail lent et patient pour façonner son identité à partir de celle qui nous a été imposée par l’ordre social. C’est pourquoi on ne s’affranchit jamais de l’injure, ni de la honte. D’autant que le monde nous lance à chaque instant des rappels à l’ordre, qui réactivent les sentiments qu’on aimerait oublier, qu’on croit parfois avoir oubliés. Si le personnage de Divine, dans Notre-Dame-des-Fleurs, après avoir dépassé le stade de l’enfance ou de l’adolescence, où la honte l’écrasait, pour se transformer en une figure flamboyante de la culture interlope de Montmartre, rougit à nouveau quand une injure lui est adressée, c’est parce qu’il lui est impossible d’ignorer les forces sociales qui l’environnent et l’assaillent – celles de la norme – et donc les affects que celles-ci ont inscrits et réinscrivent sans cesse au plus profond du psychisme des individus stigmatisés. p.228
On chemine toujours en équilibre incertain entre la signification blessante du mot d’injure et la réappropriation orgueilleuse de celui-ci. On n’est jamais libre, ou libéré. On s’émancipe plus ou moins du poids que l’ordre social et sa force assujettissante font peser sur tous et à chaque instant. Si la honte est une « énergie transformatrice », selon la belle formule d’Eve Kosofsky Sedgwick, la transformation de soi ne s’opère jamais sans intégrer les traces du passé : elle conserve ce passé, tout simplement parce que c’est le monde dans lequel on a été socialisé et qu’il reste dans une très large mesure présent en nous aussi bien qu’autour de nous au sein du monde dans lequel on vit. Notre passé est encore notre présent. Par conséquent, on se reformule, on se recrée (comme une tâche à reprendre indéfiniment), mais on ne se formule pas, on ne se crée pas.
Il est donc vain de vouloir opposer le changement ou la « capacité d’action » (agency) aux déterminismes et à la force autoreproductrice de l’ordre social et des normes sexuelles, ou une pensée de la « liberté » à une pensée de la « reproduction »... puisque ces dimensions sont inextricablement liées et relationnellement imbriquées. Tenir compte des déterminismes ne revient pas à affirmer que rien ne peut changer. Mais que les effets de l’activité hérétique qui met en question l’orthodoxie et la répétition de celle-ci ne peuvent être que limités et relatifs : la « subversion » absolue n’existe pas, pas plus que « l’émancipation » ; on subvertit quelque chose à un moment donné, on se déplace quelque peu, on accomplit un geste d’écart, un pas de côté. Pour le dire en termes foucaldiens : il ne faut pas rêver d’un impossible « affranchissement », tout au plus peut-on franchir quelques frontières instituées par l’histoire et qui enserrent nos existences.
Capitale fut donc pour moi la phrase de Sartre : « L’important n’est pas ce qu’on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-même de ce qu’on a fait de nous. » Elle constitua vite le principe de mon existence. Le principe d’une ascèse : d’un travail de soi sur soi.
Cette phrase prit cependant dans ma vie un double sens et valut aussi bien, mais de manière contradictoire, dans le domaine sexuel que dans le domaine social : en m’appropriant et en revendiquant mon être sexuel injurié dans le premier cas ; en m’arrachant à ma condition sociale d’origine dans le second. Je pourrais dire : d’un côté en devenant ce que j’étais et, de l’autre, en rejetant ce que j’aurais dû être. Pour moi, les deux mouvements allèrent de pair.
Au fond, j’étais marqué par deux verdicts sociaux : un verdict de classe et un verdict sexuel. On n’échappe jamais aux sentences ainsi rendues. Et je porte en moi la marque de l’un et de l’autre. Mais parce qu’ils entrèrent en conflit l’un avec l’autre à un moment de ma vie, je dus me façonner moi-même en jouant de l’un contre l’autre. p.229-230
Quand le marxisme dominait la vie intellectuelle française, à gauche en tout cas, à l’époque de mes études, au cours des années 1960 et 1970, les autres « luttes » paraissaient « secondaires » ou, même, étaient dénoncées comme des « diversions petites-bourgeoises » qui détournaient l’attention du seul combat digne d’intérêt, du seul « vrai » combat, celui de la classe ouvrière. En insistant sur toutes les dimensions que le marxisme avait laissées de côté – la subjectivation sexuée, sexuelle ou raciale, entre autres... – parce qu’il concentrait son attention exclusivement sur l’oppression de classe, les mouvements que l’on désigna comme « culturels » furent amenés à proposer d’autres problématisations de l’expérience vécue, et à négliger, dans une très large mesure, l’oppression de classe.
Doit-on admettre que la censure qu’exerçait le marxisme et qui repoussait hors des cadres de la perception politique et théorique un ensemble de questions telles que le genre ou la sexualité ne pouvait être contournée qu’en censurant ou refoulant ce que le marxisme nous avait accoutumés à « percevoir » comme l’unique forme de domination ? Et que, par conséquent, la disparition du marxisme, ou du moins son effacement comme discours hégémonique à gauche, aura été la condition nécessaire pour qu’il devienne possible de penser politiquement les mécanismes de l’assujettissement sexuel, racial, etc., et de la production des subjectivités minoritaires ? Il est probable que oui.
Mais pourquoi nous faudrait-il choisir entre différents combats menés contre différentes modalités de l’assujettissement, pourquoi faudrait-il instituer l’une plutôt que l’autre comme foyer central de la préoccupation politique, même si l’on sait que tout mouvement a tendance à imposer comme primordiaux et prioritaires ses principes spécifiques de division du monde social ? Et si ce sont les discours et les théories qui nous permettent de ne jamais négliger tel ou tel aspect, de ne laisser hors du champ de la perception ou hors du champ de la perception ou hors du champ de l’action aucun domaine de l’oppression, aucun registre de la domination, aucune assignation à l’infériorité, aucune honte liée à l’interpellation injurieuse...? Des théories qui nous permettent aussi d’être prêts à accueillir tout mouvement nouveau qui voudra porter sur la scène politique des problèmes nouveaux et des paroles qu’on n’y entendait ou qu’on n’y attendait pas ? p.244-5




