Accueil > Reporter sans oeillères
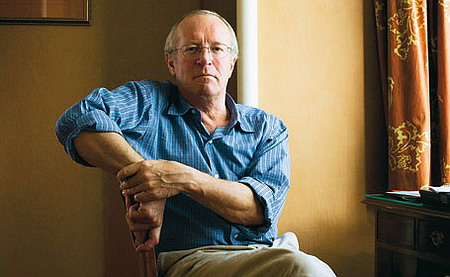
Les bellicistes du monde entier prétendent toujours partir en guerre pour la civilisation." ( Robert Fisk )
Robert Fisk participera à une conférence le 27 octobre à 18h30 à l’Institut du monde arabe, 1, rue des Fossés-Saint-Bernard, Paris 5e. Tél. : 0140513838
Légende de la presse anglo-saxonne, spécialiste du Moyen-Orient, le reporter anglais Robert Fisk raconte sa fascination pour le monde arabe
N’envoyez jamais un e-mail à Robert Fisk. Le plus célèbre correspondant de la presse étrangère au Moyen-Orient, l’homme qui a rencontré trois fois Ben Laden, entretient un rapport ombrageux avec les nouvelles technologies. Grand reporter pour le quotidien anglais The Independent (véritable mythe de la presse anglo-saxonne), cette réincarnation d’Albert Londres - le chapeau en moins, et deux yeux bleu piscine en plus - n’accepte de ses amis que des lettres manuscrites.
Celui qui parcourt depuis plus de trente ans tous les champs de bataille du monde arabe semble craindre davantage son clavier d’ordinateur qu’une kalachnikov.
Fervent défenseur de la "tradition orale", le facétieux Robert Fisk nous fixe donc, par téléphone, un rendez-vous chez lui, à Beyrouth, en parlant de lui-même, comme Alain Delon, à la troisième personne. Humour anglais ? Partant vers l’Orient compliqué avec des idées simples, comme aurait dit le Général, et pressé de rencontrer cette légende vivante, nous redoutons inconsciemment, en débarquant à Beyrouth, de mettre un visage sur la plume renommée... un peu comme le voyageur craignant que Tombouctou ou Zanzibar ne soient pas à la hauteur de leur pouvoir évocateur.
Des craintes vite balayées. Car ce n’est pas un vieux baroudeur revenu de tout, un reporter cynique ou désabusé, que nous rencontrons, une chope de thé à la main sur son balcon-vigie ouvert sur la grande bleue, mais un écorché de la vie, pétri de doutes et d’humanité, qui avoue haïr la guerre, toutes les guerres : « Pour un journaliste, la guerre est une expérience unique, à la fois douloureuse et attirante. D’une certaine façon, c’est une drogue dont il faut se débarrasser. Sinon le journaliste peut en mourir... » écrit Robert Fisk au début des mille pages du récit-fleuve qu’il publie ce mois-ci en France, en même temps qu’à Beyrouth et aux Etats-Unis. D’ailleurs, Fisk parle avec une triste ironie de ces journalistes qu’il croise sur chaque conflit, et qui prennent des risques insensés parce qu’ils « regardent la guerre comme si c’était un film ».
La Grande Guerre pour la civilisation est le roman de sa vie, et celui des mille morts auxquelles il a échappé. C’est surtout le regard d’un amoureux du Moyen-Orient, qui a « toujours été fasciné par "l’autre camp", par la vision des vaincus ». La guerre, encore et toujours. Comme un horizon personnel, indépassable. Un cauchemar à chasser et pourchasser. Le titre du livre-mémoire rend aussi un hommage ambigu à Bill Fisk, son père, ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Un père au caractère dur, verrouillé, secrètement jaloux du succès professionnel de son fils. Quand ce poilu anglais est mort, à 93 ans (« juste après la première guerre du Golfe », se souvient son fils), Robert Fisk a hérité de ses médailles. Sur l’une d’entre elles étaient gravés ces mots : « La grande guerre pour la civilisation. » Le journaliste y a vu une définition ironique de ce monde en furie : « Les bellicistes du monde entier prétendent toujours partir en guerre "pour la civilisation". »
Sa « grande guerre » à lui, Robert, fils de Bill, l’a vécue dans les années 80, sur le front Irak-Iran. Dans les marais de Bassora, les tranchées et les combats au corps à corps qui ressemblaient tellement à la guerre de 14-18 de son père (il faut lire, absolument, ces deux chapitres, suffocants, qui rendent justice à ce million de morts oubliés).
L’autre grande aventure de Robert Fisk, ce sont ses rencontres exceptionnelles avec Ben Laden, ce « cheikh Oussama » qu’il décrit avec une étonnante proximité, effrayant et fascinant à la fois. Au Soudan, puis dans les montagnes afghanes, trois fois avant le 11 septembre 2001, le reporter anglais conversera avec lui. A Khartoum, au début des années 90, c’est un jeune milliardaire spartiate que rencontre Robert Fisk, un Ben Laden presque timide, aux paroles mûrement réfléchies : « Le seul Arabe que j’aie rencontré qui se tait et réfléchit avant de parler ! » Quelques années plus tard, il retrouve dans l’Afghanistan des talibans un homme « qui avait en lui quelque chose d’inquiétant, car il possédait cette qualité qui distingue les hommes prêts à se battre : il était absolument sûr de lui ». Un Ben Laden prévenant, à l’écoute, mais « avec cet air assuré et ce soupçon de vanité que je trouvais si perturbants ».
Dans les remerciements, à la fin de son livre, le journaliste est même à deux doigts de gratifier son étrange hôte. Pour lui avoir offert trois scoops&nsbp; ? Pour l’avoir laissé repartir en vie, escorté sur les routes afghanes par un tueur algérien du GIA en guise d’ange gardien ? Ou pour d’autres raisons encore : mélange d’excitation professionnelle, de fascination et d’esprit de contradiction face à un antihéros « tellement démonisé » ?
C’est après avoir noué cette relation unique avec Ben Laden que Robert Fisk se retrouve, le 11 septembre 2001, dans un avion, en route pour l’Amérique, avant de faire demi-tour au-dessus de la mer d’Irlande. Les tours du World Trade Center sont en feu : « Ces quatre appareils (aux mains des pirates de l’air) avaient décollé de la même façon que le nôtre, témoigne-t-il dans La Grande Guerre pour la civilisation. Je marchais le long du couloir de l’avion et demandais le point de vue des membres de l’équipage [...]. Je crois que je revins avec gravées dans mon esprit les images de treize passagers, personnes que je n’appréciais pas parce qu’elles portaient la barbe, parce qu’elles me fixaient d’une manière que je pouvais facilement prendre pour de l’hostilité, parce qu’elles jouaient avec leur chapelet ou lisaient leur Coran. En quelques minutes, le Fisk si ouvert qui avait travaillé au Moyen-Orient durant un quart de siècle, qui avait vécu avec des Arabes pendant la moitié de son existence, dont la vie avait été sauvée à d’innombrables reprises par des musulmans au Liban, en Irak et en Iran, oui ce Fisk si gentil et amical était devenu raciste. [...] Je me sentais sale. Je soupçonnais cependant que tout ceci était un des buts mêmes de cette journée tragique. Nous faire ressentir la saleté en nous-mêmes, nous faire si peur ou nous rendre si furieux que nous n’agirions plus rationnellement à l’avenir. »
A presque 60 ans, sans enfants (« heureusement ! »), Robert Fisk n’entend toujours pas abandonner le terrain pour une place de rédacteur en chef à Londres. Après trois décennies à sillonner le Moyen-Orient depuis Beyrouth, il hésite depuis peu à retourner à Bagdad, mais il veut assister « au dernier épisode de la défaite américaine en Irak ».
Fisk, l’opposant à la guerre en Irak, la mauvaise conscience de la presse anglo-saxonne, injurié, menacé publiquement pour ses positions anti-Bush par l’acteur américain John Malkovich, n’a jamais paru aussi nécessaire. Fisk, l’antivirus contre toutes les « saletés » qui mènent aux grandes guerres pour la civilisation.
Avec Thierry Leclère
A lire :
La Grande Guerre pour la civilisation, L’Occident à la conquête du Moyen-Orient (1979-2005), de Robert Fisk, éd. La Découverte, 960 p., 30 euros
A participer :
Robert Fisk participera à une conférence le 27 octobre à 18h30 à l’Institut du monde arabe, 1, rue des Fossés-Saint-Bernard, Paris 5e. Tél. : 01 40 51 38 38




