Accueil > LES RELOCALISATIONS : FEDERALISTE ET SOCIALE CONTRE NEOLIBERALE ET D’EXTREME (…)
LES RELOCALISATIONS : FEDERALISTE ET SOCIALE CONTRE NEOLIBERALE ET D’EXTREME DROITE
par Thierry Burgvin – Sociologue
Publie le mercredi 2 novembre 2016 par Thierry Burgvin – Sociologue - Open-Publishing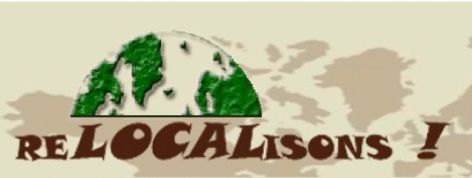
Actuellement, contre la mondialisation néolibérale, plusieurs courants largement antagonistes font la promotion de la relocalisation. Cette dernière préoccupe autant l’écologie sociale, que les partisans de l’autonomie économique de gauche (la démondialisation de Montebourg), que d’extrême droite. Or, si l’autonomie locale est un fondement des politiques économiques libertaires ou décroissantes, certains secteurs ne peuvent néanmoins pas être complètement délégués au niveau local.
La relocalisation fédéraliste et sociale est fondée sur la relocalisation de la production et la régulation fédéraliste de la fiscalité, du social et de l’écologie. Il faut en effet, éviter deux excès, celui du centralisme républicain, internationaliste ou mondialiste et l’autre excès : le régionaliste, nationalisme xénophobe, égoïste et guerrier.
Une relocalisation non sociale et non sélective s’inscrit dans une politique autarcique relevant d’une décroissance d’extrême droite.
Elle consiste dans un repli excessif sur soi, sur le local, sa nation, sans prendre en compte les pays et les régions les plus pauvres. Dans un contexte quelque peu différent, puisqu’il s’agit de politique intérieure, la Lombardie (en Italie du Nord), ou la Serbie (dans l’ex-Yougoslavie) ont chacune à leur manière cherchée à se séparer des régions les plus pauvres de leur pays par exemple.
En effet, une relocalisation sélective et sociale et suppose aussi la prise en compte, de cette dette économique, écologique et sociale, liées aux relations historiques des « pays du Nord envers ceux Sud ». C’est à dire, qu’elle peut consister dans un soutien économique réel aux pays les plus faibles économiquement, afin de rembourser cette dette. Cette aide peut prendre différentes formes, (l’aide publique au développement), ou encore les taxes écologiques (Robin Hood tax), financière (taxe Tobin) visant à faire payer les pollueurs ou les spéculateurs et à aider les plus faibles. Cependant, il s’agit de prendre garde, aux stratégies de retournement consistant pour les élites dominantes à détourner une bonne mesure en son contraire que ce soit l’aide publique, l’écologie ou la relocalisation...
Les besoins essentiels, le développement autonome et l’identité culturelle sont les trois principes d’une relocalisation décroissante écosocialiste.
De plus, ils sont interdépendants et synergiques observe Roy Preiswerk (1980). En répondant aux besoins essentiels des populations, en stimulant par exemple la production des cultures vivrières, en permettant l’éducation de base, en répondant aux besoins locaux avant de suivre la demande internationale, le pays devient ainsi plus autonome et peut assurer sa croissance à long terme. Un développement basé sur la « self reliance », c’est-à-dire l’autonomie, signifie en quelque sorte un développement plus endogène ou autocentré. Il renforce l’identité culturelle en centrant les efforts de développement sur les ressources (au travers la participation des populations notamment) et les connaissances propres du pays.
La réappropriation par une population de son identité culturelle favorise l’autonomie, car elle permet de trouver confiance dans son propre potentiel. Elle peut permettre aussi une meilleure réponse aux besoins des populations, car elle peut orienter l’attention du gouvernement sur les préoccupations essentielles des populations. Chaque peuple en développant ses qualités spécifiques, peut faire émerger ou retrouver dans sa culture, son identité, son "génie" propre. La technologie appropriée peut être un moyen de découvrir des techniques spécifiques ou d’adapter des technologies extérieures aux besoins du pays. L’identité culturelle est notamment renforcée grâce à l’amélioration de l’éducation, l’usage de la langue maternelle dans les manuels scolaires et par les enseignants, l’appui sur les compétences humaines locales, la reconnaissance des traditions… Tous cela favorise l’unité du pays et c’est bénéfique pour la cohésion sociale. Mais cela ne doit pas conduire pour autant au nationalisme identitaire.
La redistribution a une fonction de cohésion sociétale du niveau individuel au niveau global.
Dans les social-démocraties, comme dans l’écosocialisme autogestionnaire, au niveau individuel la redistribution permet d’éviter les trop grands écarts, de salaire, de revenu, de patrimoine. Au niveau des coopératives, elle permet d’éviter que les plus puissantes absorbent les plus petites. Au niveau régional, la redistribution permet une solidarité entre territoires, c’est-à-dire entre les communes, les régions ou les nations les plus riches vis-à-vis des plus pauvres. La tentation des territoires les plus riches consiste souvent à vouloir s’affranchir des différentes formes de redistribution économiques, qu’ils considèrent comme un impôt injuste, qui pèse sur eux, le peuple travailleur et d’aider un peuple paresseux. Les différences identitaires et culturelles s’y ajoutent souvent, mais sont généralement des prétextes, liés à des égoïsmes économiques.
Concernant l’axe redistributif, pour les territoires qui cherchent la justice et la paix, l’équilibre est difficile à trouver entre le pole de l’autonomie territoriale sans redistribution, qui conduit à l’égoïsme et agressivité (comme le nationalisme capitaliste) et le pôle de l’ Etatisme autoritariste (stalinien, jacobin), qui conduit sous prétexte d’égalité à imposer des principes et des règles communes partout parfois inadaptée. Ce qui va nuire à l’autonomie (politique), à la liberté d’instaurer d’une plus grande solidarité économique (en proposant par exemple un Smic plus élevé, une meilleur système d’assurance maladie…).
Relocalisation fédéraliste contre internationalisme
Il existe plusieurs formes d’altermondialisme, celui porté par l’association Attac, promeut le renforcement des organisations internationales, tel l’ONU et court le risque d’un centralisme excessif. L’internationalisme, tend à dissoudre les nations pour créer une humanité sous la direction d’un gouvernement mondialisé et non un gouvernement international, qui supposerait qu’il existe encore des nations.
Cependant, l’autonomie économique, ne signifie pas pour autant égoïsme nationaliste. Une part des richesses, de la production et des services peut continuer à être échangé, entre pays ou régions dans un but de solidarité (sans ingérence). Sans l’autonomie économique, l’autonomie politique est quasiment impossible.
Le véritable fédéralisme, n’est pas une fédération centralisée, mais un fédéralisme fondé sur la subsidiarité, tel qu’il a été pensé à l’origine notamment par Proudhon. C’est-à-dire que les décisions prises au niveau supérieur, ne peuvent être prises que si elles sont impossibles ou inadaptées à l’échelon inférieure, tel la création d’un réseau ferroviaire. De plus, un certain droit d’autonomie doit être possible, lorsqu’une décision collective n’est pas acceptée par un échelon inférieur, une commune, une région ou une nation.
Le « fédéralisme unitaire » se rapproche de la démocratie républicaine, qui visent avant tout l’égalité entre les sujets sur un territoire donné, un Etat, mais entre les membres d’une fédération d’Etat, de régions, de communes ou de coopératives. Dans ce cas fédéralisme décentralisé s’oppose au fédéraliste unitaire et à la démocratie républicaine. Ces deux derniers visent à éviter par exemple que la fiscalité ou les salaires minimums soient trop bas dans certaines zones (communes, régions…). Ce qui favoriseraient le dumping social, les inégalités économiques et la concurrence vers le « moins disant social » entre salariés ou unités de production. Cependant, les dérives de la démocratie républicaine et de « fédéralisme unitaire » résident dans les risques de centralisme, avec ces décisions imposés d’en haut sans consultation, l’uniformisation des modes de vie et des pratiques professionnelles et plus généralement dans le manque de liberté et donc d’autonomie dans les choix des acteurs situés à la base.
Les écosocialistes autogestionnaires cherchent donc à trouver un équilibre entre un internationalisme, ou un altermondialisme, écrasant les spécificités culturelles et les autonomies des localités et des nations et une relocalisation nationaliste égoïste, en développant une relocalisation fédéraliste et sociale, entre les dérives d’un centralisme coercitif et uniformisant d’un côté et de l’autre les excès d’une démondialisation trop nationaliste et égoïste.





